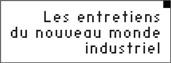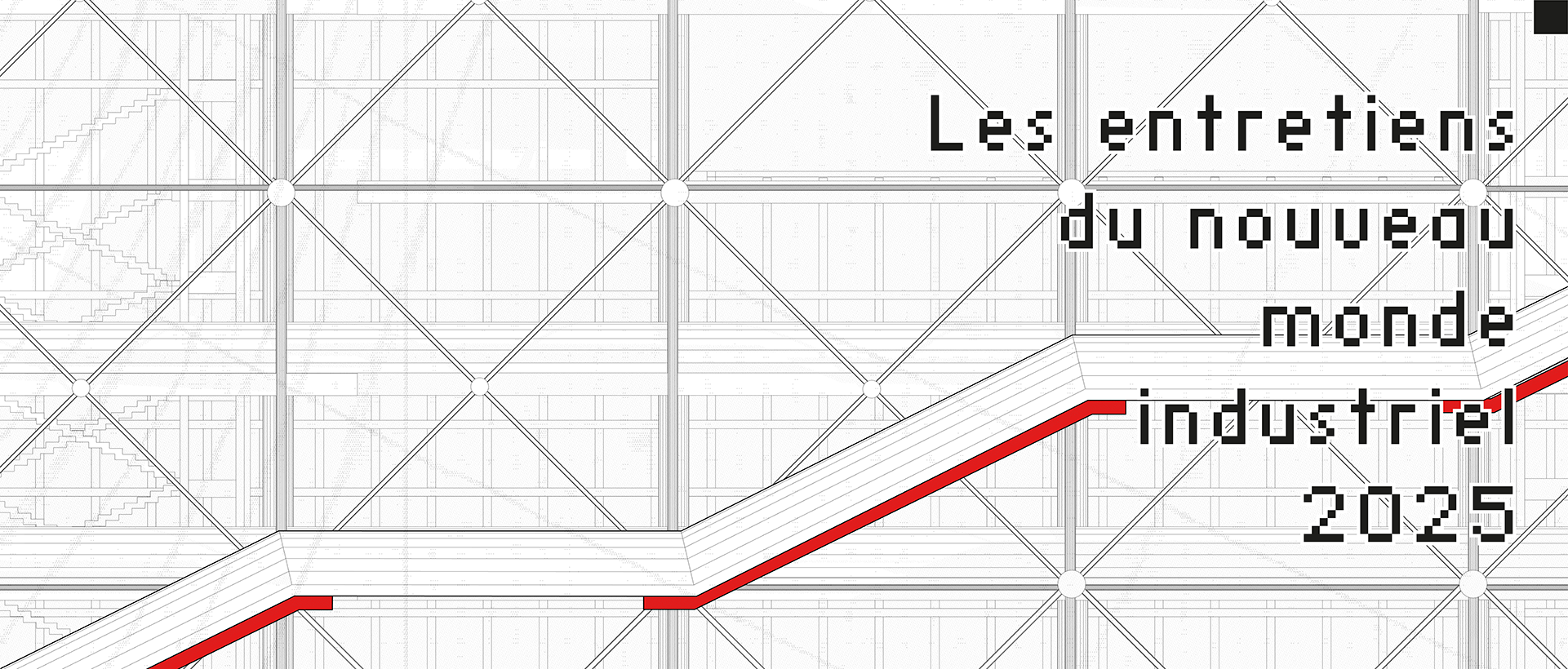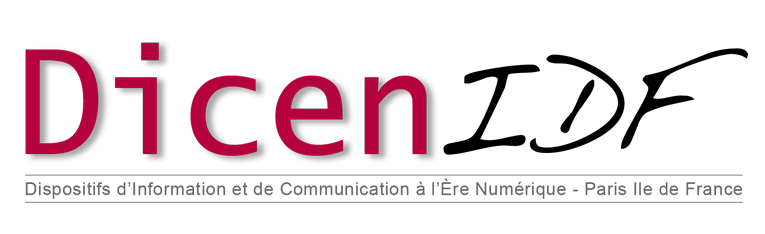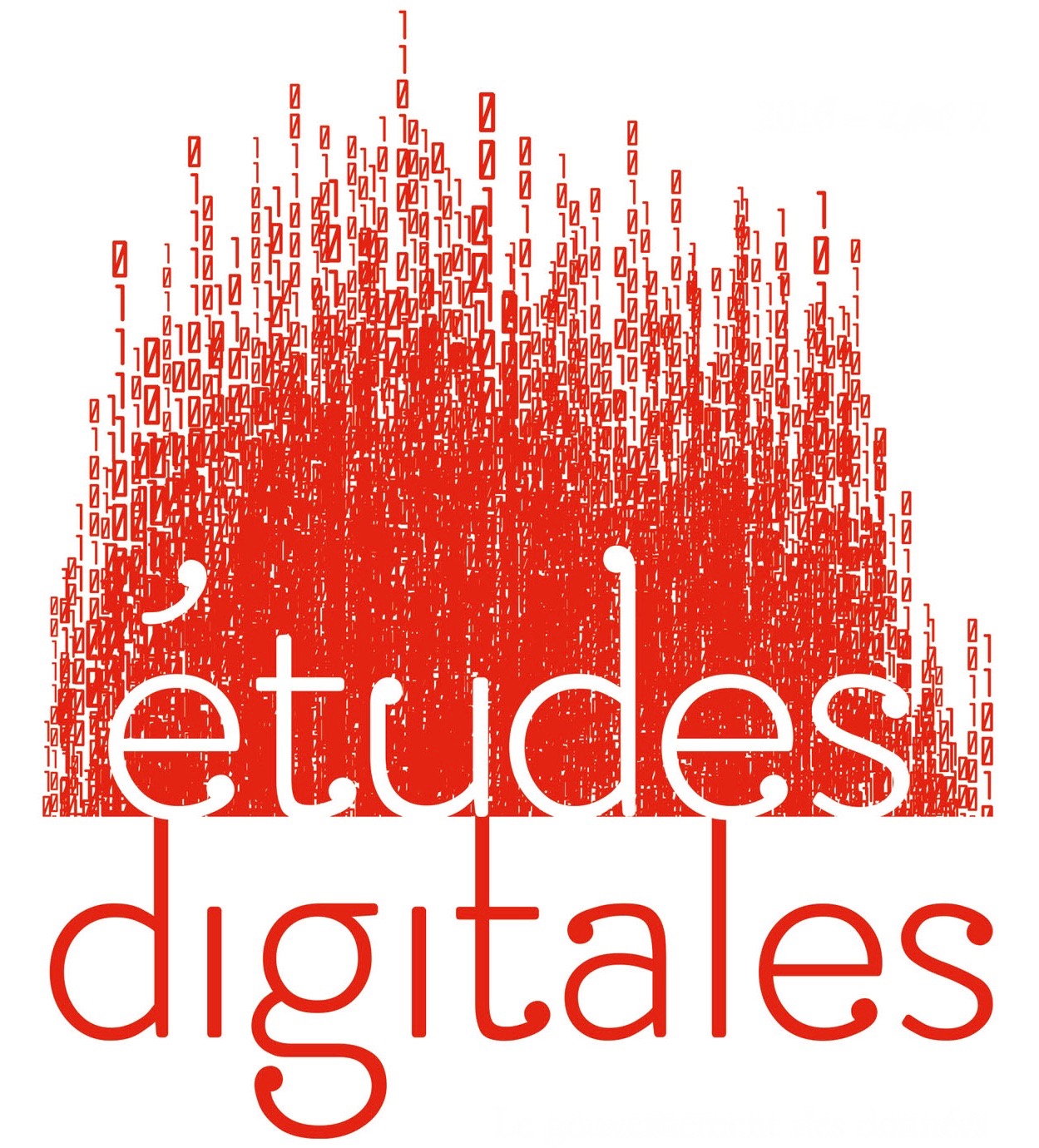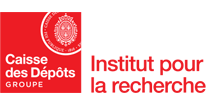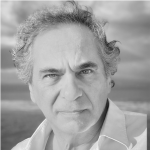16 et 17 décembre 2025
Synthèse artificielle et contribution humaine
quelle économie pour de nouveaux milieux des savoirs ?
Retrouvez les enregistrements de cette édition sur le site iri-ressources.org.PRÉSENTATION
Synthèse artificielle et contribution humaine
16 et 17 décembre 2025
Amphithéâtre Abbé Grégoire
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) Paris
292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris
et en visio-conférence
« Garbage Out ». Dans son numéro du 25 juillet 2024, le journal Nature sonnait l’alerte en dénonçant en couverture le fait qu’une IA nourrie de ses propres données évolue entropiquement vers du « charabia ». L’article des chercheurs d’Oxford et de Cambridge nous semble apporter des arguments solides pour que la contribution humaine soit reconnue comme un facteur déterminant de lutte contre ce que les chercheurs appellent un « effondrement » des modèles dits de « langage » (LLM). De la même manière que nous avons besoin d’analyser un texte pour en faire la synthèse, l’IA a besoin de l’humain pour créer des modèles qui offrent de nouvelles appréhensions synthétiques du réel. Dès lors, comment peut-on penser les nouvelles articulations entre modèles de synthèse artificielle, processus d’analyse humaine et dispositifs de contribution collective ? Ce nouvel agencement nous semble appeler une nécessaire reconnaissance de la valeur du savoir-faire humain dans le cadre d’une économie contributive, fondée localement et qui ne se réduit pas à une exploitation gratuite ou à un « travail du clic » aux conditions économiques, sociales et psychologiques largement dénoncées.
C’est sur la base de ce plaidoyer, que nous proposons de revenir cette année sur ce qui semble pourtant surcharger l’espace médiatique et la production scientifique depuis deux ans. Faut-il pour autant se joindre à ceux qui dénoncent la menace de l’IA générale ? S’agit-il de prolonger le contre-sommet de l’IA proposé en février par le philosophe Eric Sadin ? Y-a-t-il encore un espoir d’articuler des modèles d’analyse symbolique avec la synthèse statistique ? Ou encore des pratiques contributives et des savoirs collectifs avec des modèles de synthèse statistiques pour repenser de nouveaux milieux des savoirs et de nouveaux réseaux sociaux ? La question de la synthèse sera au centre de notre recherche pour 2025 afin de tenter d’illustrer comment les technologies contributives–telles qu’elles ont pu se développer dans la tradition des sciences des bibliothèques, dans le champ sémantique, et avec le développement majeur de Wikipédia–peuvent s’articuler aujourd’hui à des outils de synthèse « artificielle » pour une nouvelle écologie de l’esprit.
Mais que faut-il entendre par synthèse « artificielle » ? Il faudrait tout d’abord s’intéresser au processus proche de l’intégration en biologie, tel qu’il ne se réduit pas au processus chimique de la photosynthèse. Il s’agit aussi de rappeler les travaux fondateurs en matière d’analyse et de synthèse du son et de l’image qui ont été développés à partir de modèles symboliques ou sémantiques beaucoup plus compréhensibles par l’humain avant de n’être surpassés par des modèles probabilistes fondés sur le traitement de grandes masses de données. Et bien avant cela, on pourra critiquer la question de la synthèse telle qu’elle fut pensée par Kant comme un processus de l’imagination articulant synthèse perceptive ou pré-catégorielle dans la sensibilité, synthèse reproductive grâce à la mémoire, synthèse intellective et catégorielle dans l’entendement. L’écoute de la musique suppose ces trois phases : j’attends, je reconnais, j’associe. La synthèse ne se réduit donc pas à un assemblage: elle annonce l’articulation de diverses opérations psychiques et collectives. Parler de synthèse « artificielle » nous permet de dépasser le clivage naturel-artificiel et d’explorer le riche monde de la synthèse pour le vivant, pour l’imagination, pour la technique. Il s’agit ainsi de distinguer synthèse organique, symbolique, statistique afin de pe(a)nser la synthèse « organologique » à la suite de Bernard Stiegler. Il s’agit aussi, comme l’a souligné Yuk Hui dans sa lecture de Kant, de faire fonctionner à nouveaux frais le conflit des facultés (humaines et algorithmiques) dans le contexte d’une organologie qui nous ouvre à de nouveaux espaces où, comme chez Simondon, l’imagination conduit à l’invention et où l’anticipation permet de renouveler le cycle des images opératives et les diverses facultés qu’elles induisent.
L’imagination serait en fait plutôt à considérer comme un équilibre fragile entre conditionnement et liberté mais où le degré de liberté lié à notre perception est aujourd’hui de plus en plus pris en charge par la masse de données. Adaptation ? hybridation ? délégation à une matière imaginaire qui nous est humainement inaccessible comme le propose Michael Crevoisier ? adoption d’un nouveau régime de sensorialité performatif comme le propose Anaïs Nony ? Dès lors, Comment la menace de cette disruption de l’imaginaire par la masse de donnée des LLMs se joue-t-elle dès l’enfance ? Et comment la pratique artistique peut encore s’y appuyer de la même manière qu’un acteur apprend son texte par cœur, « s’automatise », pour pouvoir le dépasser, improviser, avancer vers une « idée esthétique » encore indéterminée, c’est-à-dire réellement penser l’incalculable à partir du calculable ou « l’infini » à partir du fini ? Ce sont des options esthétiques, épistémologiques, technologiques mais aussi politiques qu’il nous faudra explorer.
Les Entretiens du Nouveau Monde Industriel 2024 nous ont ouvert des pistes de réflexion pour une nouvelle écologie de l’industrie qui prend soin de son milieu numérique. La question de l’IA était déjà en discussion. En 2025, notre objectif est de prolonger cette perspective en examinant et distinguant précisément ce qui relève de l’analyse et ce qui relève de la synthèse dans ces modèles statistiques et comment il est nécessaire de les ré-articuler à des modèles symboliques et à des dynamiques contributives au service d’une hyper-interprétation comme synthèse de plusieurs interprétations pour le développement de nouveaux savoirs. La synthèse coupée de toute compréhension de l’analyse, des sources, des grammaires, des règles, des contextes, entretient l’aspiration à développer une IA générale biaisée, dominante, autonome, déterritorialisée, délocalisée, mais incluant progressivement le contexte dans son calcul. Cette tendance a-signifiante de l’IA est une menace pour la technodiversité et la noodiversité qui renforce les arguments spéculatifs d’un nouveau capitalisme algorithmique hégémonique.
À travers les Entretiens du Nouveau Monde Industriel et la publication l’année suivante d’un ouvrage collectif, nous aimerions croiser ici des regards théoriques, politiques, économiques, artistiques et industriels, pour mieux comprendre comment ré-articuler analyse, synthèse et imagination à l’ère des IA. La menace est immense mais nombreux sont les projets qui visent à des agencements très innovants entre technologies sémantiques, statistiques et contributives (ce dernier point constituant toujours le cœur de nos projets technologiques et d’innovation sociale et territoriale notamment en Seine-Saint-Denis (https://tac93.fr).
Dans le cadre de nos entretiens, pour mieux comprendre les enjeux et les tensions et proposer de nouvelles approches industrielles, nous partons de la richesse et de la diversité des « localités » qui produisent de nouveaux savoirs. Est-ce que les fablabs, les usines distribuées, les circuits courts, l’économie circulaire, les projets low-tech et les coopératives numériques peuvent contribuer à une dynamique d’innovation ascendante qui crée une « nouvelle écologie industrielle » ?
Dans le cadre de nos Entretiens préparatoires, nous proposons d’aborder ce thème selon six perspectives convergentes :
1. Synthèse artificielle et contribution : critique et prospective techno-politique et industrielle
2. Analyse, synthèse, imagination : questions épistémologiques
3. Synthèse artificielle, nouveaux métiers, nouveaux collectifs
4. De l’image de synthèse à la synthèse d’image : la disruption du sensible
5. Pour une économie de la contribution : cadre juridique et cadre de confiance
6. Sémantique, statistique, contribution : le design de nouveaux agencements
Ce thème transversal conçu et préparé avec notre Collège scientifique et industriel converge avec le rapport sur l’IA des Lumières que Cap Digital vient de publier, sous la direction de Francis Jutand qui fut un des fondateurs des ENMI en 2007 ! C’est aussi le prolongement d’un partenariat avec la Fondation Feltrinelli avec qui nous avions déjà collaboré en 2021 (https://fondazionefeltrinelli.it/scopri/report-parigi-okeurope-2021/) sur la question des mutations du travail. Deux événements plus récents ont aussi inspiré cette proposition : le séminaire hyper-interprétation organisé l’année dernière par l’IRI sous la direction de Franck Cormerais et Armen Khatchatourov (https://iri-ressources.org/collections/collection-55.html) et la Journée sur le mouvement Wikimédia organisée le 14 mars par Marta Severo et Antonin Segault au Dicen/Cnam-Un. Paris Nanterre (https://wikimouv2025.sciencesconf.org/).
Retrouvez les enregistrements
Retrouvez les enregistrements de cette édition sur le site iri-ressources.org.
Affiche

Visio-conférence et live
En visio interactive ou en live streaming simple
Commentez et catégorisez
Avec les repères suivants, depuis la visio ou sur les réseaux avec les hashtags #iri #enmi25, afin d’enrichir la session et l’enregistrement
| ++ | [Important] |
| ** | [Index] |
| ?? | [Trouble] |
| == | [Commentaire] |
Crédits
Affiche et entête : Willhelm Benjamin (auteur), Caroline Zeller (directrice artistique)
Programme
Programme
Session 1 : Synthèse artificielle et contribution : critique et prospective techno-politique et industrielle
Une vision historique et prospective sur la composante synthétique de l’IAG qui disrupte l’économie mondiale dans le contexte d’un techno-capitalisme hors sol qui tend, par les IA générales ou génériques à réduire ses contextes, métiers, territoires à leur calculabilité, et court le risque d’une dégradation de ses performances s’il ne tisse pas de nouvelles alliances avec la contribution humaine et en premier lieu avec la science. Quel régime de vérité ou quel régime de « facticité », pour reprendre le terme d’Antoinette Rouvroy, se dessine avec cette disruption ?
Mardi 16 décembre – 9h30-12h30
INTRODUCTION :
Vincent Puig, IRI
Manuel Zacklad, DICEN-CNAM
INTERVENANTS :
Guillaume Pellerin, ingénieur, chercheur (IRI)
Dominique Boullier, sociologue
Giuseppe Longo, mathématicien (ENS-CNRS)
Antoinette Rouvroy, philosophe (Un. De Namur)
Laurence Allard, chercheuse (Un. Paris III)
Session 2 : Analyse, synthèse, imagination : questions épistémologiques
Une perspective philosophique et épistémologique : qu’est-ce que la synthèse dans le champ biologique par exemple dans le contexte de la photosynthèse ? Inversement et dans une perspective kantienne, la synthèse n’a-t-elle pas toujours été « artificielle » ? Comment la perspective contributive et la question des catégories peut-elle encore être une voie de dialogue avec les IA ? Quelle analyse historique sur cette évolution et quel nouveau regard sur l’informatique théorique dès lors que les approches symboliques et statistiques se combinent ? Comment les produits de synthèse peuvent-ils être recontextualisés à leurs sources, à leurs méthodes d’analyse, et à la contribution humaine comme le propose Jaron Lanier9 ? Peut-on designer des outils de synthèse pas seulement pour des individus mais surtout pour des groupes ? Quelle écologie des milieux synthétiques ?
Mardi 16 décembre – 14h00-16h30
INTERVENANTS :
Maël Montévil, mathématique et biologie (CNRS/ENS)
Michäel Crevoisier, philosophe (Un. De Franche-Comté)
Pierre Saint-Germier, chercheur (IRCAM)
Mathieu Triclot, philosophe (UTBM)
Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre (IRI)
Session 3 : Synthèse artificielle, nouveaux métiers, nouveaux collectifs
Une étude critique des publications contradictoires sur la destruction de l’emploi par les IA ne suffit pas. Il convient de reconnaître l’importance du « digital labor10 » et la misère physique, psychique et symbolique des travailleurs du clic11. Mais aussi distinguer ce qui au cœur de nos métiers relève à présent de tâches automatisables–en analyse comme en synthèse des connaissances–sans les confondre avec leur pratique collective dans le champ incalculable des savoirs. S’agit-il d’une destruction nette de l’emploi ou plutôt d’une déqualification tendancielle due à la prolétarisation qui s’inscrit désormais de manière générale et selon une échelle planétaire? A qui bénéficie cette nouvelle productivité et comment peut-elle être mobilisée pour dégager de nouveaux espaces d’autonomie, de savoir, de pratiques contributives et donc d’un travail qui se distingue de l’emploi ?
Mardi 16 décembre – 16h30-19h00
INTERVENANTS :
Manuel Zacklad, DICEN-CNAM
Nathalie Greenan, CNAM
Nayla Glaise, dirigeante de l’UGICT-CGT et d’Eurocadres
Amaranta Lopez, EHESS
Session 4 : De l’image de synthèse à la synthèse d’image : la disruption du sensible
Un regard sur la création, sur ce qui ne sont plus des images de synthèse mais des vecteurs d’images et au-delà sur un synthèse imaginative soumise au calcul qui disrupte toutes les pratiques artistiques et les métiers créatifs. Traçabilité, nouvelles licences libres, « LLM vertueux », quelles perspectives pour l’enseignement ? Comment appréhender la nouvelle articulation des facultés d’apprentissage (mémorisation, interprétation, contemplation) et la création de nouveaux outils pour l’éducation tels que nous le propose les services libres de la digitale ?
Mercredi 17 décembre – 9h30-13h00
INTERVENANTS :
Ariel Kyrou, écrivain et journaliste
Anaïs Nony, philosophe
Valérie Cordy, La Fabrique de Théâtre
François Pachet, chercheur en IA
Farah Khelil, artiste
Caroline Zeller, artiste
Session 5 : Pour une économie de la contribution : cadre juridique et cadre de confiance
Un plaidoyer pour la reconnaissance et le soutien des dynamiques collaboratives et contributives et des règles juridiques qui dans le numérique et à l’image de Wikipédia, cherchent à défendre un milieu des savoirs ouvert sans qu’il soit l’objet d’une nouvelle forme de prédation pour nourrir (et sauver) une IA qui sinon s’appauvrit tendenciellement. Quels modèles économiques pour une redistribution plus équitable de ces profits ? Quel soutien financier à la contribution dans le contexte de territoires où les habitants, artistes, amateurs, s’appuient sur leurs « donnée contribuée » sans les commercialiser ? Comment aller au-delà de l’open source pour penser un « share source » fondé sur des données contribuées comme nous y invite aussi Francis Jutand ?
Mercredi 17 décembre – 14h30-17h00
INTERVENANTS :
Nathalie Casemajor, Centre Urbanisation Culture Société, INRS
Camille Françoise, Wikimedia France
Francesca Musiani, CIS-CNRS
Alexandre Monnin, philosophe
Francis Jutand, Institut Mines-Télécom
Session 6 : Sémantique, statistique, contribution : le design de nouveaux agencements
Des illustrations concrètes d’agencements innovants de modèles sémantiques et statistiques avec des technologies contributives pour un nouveau Web de l’interprétation, de la critique et de la démocratie renouvelant de nouvelles pratiques herméneutiques, par la catégorisation, l’annotation, l’éditorialisation ou la délibération. Une manière de repenser dans les start-ups ou les grands groupes de nouvelles formes de CivicTech, EdTech, MedTech ?
Mercredi 17 décembre – 17h00-18h30
INTERVENANTS :
Franck Cormerais, IRI – Université Bordeaux Montaigne
Bertrand Delezoide, Blue AI
Florence Jamet-Pinkiewicz, École Estienne
Mathieu Corteel, Sciences Po
Intervenants
Vincent Puig
IRI
Vincent Puig est président de l’Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou qu’il a créé en 2006 avec le philosophe Bernard Stiegler. Praticien et théoricien du numérique, il a conduit plusieurs projets de recherche à l’IRCAM, au Centre Pompidou puis à l’IRI notamment sur les technologies d’indexation, d’annotation, de catégorisation et d’éditorialisation. Il coordonne aujourd’hui des projets de recherche contributive principalement en Seine-Saint-Denis et dans la perspective d’une économie de la contribution.
Manuel Zacklad
DICEN-CNAM
Manuel Zacklad est professeur au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) en sciences de l’information et de la communication. Il a cofondé le laboratoire Dicen (CNAM, Université Gustave Eiffel, Université Paris-Nanterre), dont il est actuellement directeur adjoint pour le CNAM. Ses travaux portent sur la théorie du document (document pour l’action, documentarisation, dispositifs de médiation info-communicationnels), la théorie de l’organisation des connaissances (web socio-sémantique), ainsi que sur l’analyse de la coopération et de la communication médiatisée à travers une approche transactionnelle de l’activité inspirée du pragmatisme, formalisée dans le cadre de la Sémiotique des Transactions Coopératives.
Ses recherches actuelles portent notamment sur l’approche transactionnelle du design et du co-design, les laboratoires d’innovation dans les organisations publiques et privées, les dispositifs de transmédiation, la recherche-intervention par le co-design, les formes d’« éthique située » face à certains enjeux sociétaux (intelligence artificielle, gestion des crises sanitaires, etc.), ainsi que sur les enjeux de la datafication
Guillaume Pellerin
IRI
Guillaume Pellerin est directeur de Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou (IRI). Ingénieur Arts et Métiers et docteur en physique de Sorbonne-Université, ancien chef du pôle Innovation Web – Audio – Musique de l’IRCAM et ancien enseignant-chercheur au CNAM, il est spécialiste en acoustique, informatique, traitement du signal et des données, architectures et technologies numériques. En tant qu’entrepreneur et défenseur de l’innovation ouverte, il a conçu et dirigé le développement de plateformes participatives, culturelles et pédagogiques pour les laboratoires, les universités et les communautés artistiques (Cristal collectif CNRS 2018) dans le cadre de projets européens et internationaux orientés arts – sciences. Ses travaux interdisciplinaires portent actuellement sur la philosophie des techniques, les architectures décentralisées, le social coding et les méthodes expérimentales de recherche contributive orientées milieux.
Dominique Boullier
sociologue et linguiste
Dominique Boullier, sociologue et linguiste, est professeur des universités émérite en sociologie à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) depuis 2009 (émérite depuis 2022). Chercheur au CEE (Centre d’Etudes Européennes et de Politique Comparée). Il fut directeur du Social Media Lab à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (2015-2019), coordonnateur scientifique du médialab de Sciences Po avec Bruno Latour (2009-2013), directeur de Lutin User Lab (Cité des Sciences (2004-2008) et de Costech (Université de Technologie de Compiègne (1998-2005). Il a été aussi créateur et chef d’entreprise dans les années 90.
Il est l’auteur de plusieurs articles et ouvrages sur les questions urbaines (L’urbanité numérique, L’Harmattan, 1999 ; La ville-événement, PUF, 2010), sur les questions numériques (Sociologie du numérique, Armand Colin, 2019, 2eme édition). Il a créé et dirigé la revue Cosmopolitiques de 2002 à 2012. Ses travaux de recherche actuels portent sur les conditions techniques et institutionnelles de survie dans les univers numériques : « Comment sortir de l’emprise des réseaux sociaux » (Le Passeur éditeur, 2020), « Habiter le numérique. L’habitèle », à paraitre), sur les conditions de régulation des plateformes et des systèmes d’ IA (« Puissance des plateformes, territoires et souverainetés » (Sciences Po Chaire digital, 2021, et “Social Media Reset”, Sciences Po, 2023), et sur les mutations conceptuelles et méthodologiques que doivent réaliser les sciences sociales : « Propagations. Un nouveau paradigme pour les sciences sociales » (Armand Colin, Mars 2023.
Il vient de publier “Déshumanités numériques” chez Armand Colin, 2025. Ses travaux sont disponibles sur son site.
Giuseppe Longo
CNRS/ ENS
Giuseppe Longo est un spécialiste de logique mathématique et de l’épistémologie des mathématiques et de la biologie. Il a été d’abord professeur de Logique Mathématique puis d’Informatique à l’Université de Pise, ensuite, Directeur de Recherche CNRS aux départements de Mathématiques et d’Informatique de l’Ecole Normale Supérieure, puis au centre interdisciplinaire Cavaillès. Depuis une quinzaine d’années son oeuvre porte sur les relations entre Mathématiques et Sciences de la nature, dont en premier lieu la biologie évolutive et des organismes. Il a été adjunt professor, School of Medicine, Tufts University, Boston. Membre de l’Academia Europaea. Dans les années ’80, il a été post-doc à Berkeley et au MIT, professeur invité à Carnegie Mellon, à Oxford (GB) et Utrecht (NL), pour trois ans au total. Fondateur et rédacteur en chef de Mathematical Structures in Computer Science, Cambridge U.P. (1991-2015), il dirige une collection de livres chez Hermann, puis Spartacus IDH. Co-auteur des livres avec A. Asperti, Categories, Types and Structures. Category Theory for the working computer scientist. M.I.T. Press, 1991; avec F. Bailly, Mathematics and the natural sciences: The Physical Singularity of Life ; avec M. Montévil, Perspectives on Organisms: Biological Time, Symmetries and Singularities (Springer, Berlin, 2014). Avec A. Soto, il a édité From the century of the genome to the century of the organism: New theoretical approaches, Prog Biophys Mol Biol, 2016. Il a été responsable d’un projet à l’IEA de Nantes sur le concept de loi, en sciences humaines et de la nature (voir le volume chez Spartacus IDH avec ce titre). Son projet actuel développe une épistémologie des nouvelles interfaces explorant les corrélations historiques et des alternatives à la nouvelle alliance entre formalismes computationnels et gouvernance de l’homme et de la nature par les algorithmes et par des “méthodes d’optimalité” prétendument objectives. Son dernier ouvrage : Le cauchemar de Prométhée. Les sciences et leurs limites. Préface de Jean Lassègue, postface d’Alain Supiot. PUF, Paris, 2023.
Antoinette Rouvroy
Université de Namur
Antoinette Rouvroy est docteur en sciences juridiques de l’Institut universitaire européen (Florence, 2006), est chercheuse qualifiée du FNRS au centre de Recherche en Information, droit et Société (CRIDS). Elle s’intéresse depuis 2000, aux rapports entre le droit, les modes de construction et de du risque, les sciences et technologies, et la gouvernementalité néolibérale. Elle est chargée de cours vacataire à Sciences Po Paris (Master innovation & transformation numérique), promotrice du projet PDR FRESH (FNRS) Mise en nombres du réel et gouvernementalités contemporaines: la gouvernementalité algorithmique (2013-2017), membre du Comité de la prospective de la CNIL (France) (depuis 2012), et membre du comité scientifique des “Cahiers Droit, Sciences et Technologies” édités par le CNRS.
Laurence Allard
Université de Lille/Ircav-Sorbonne Nouvelle
Laurence Allard est maîtresse de conférences en sciences de la communication, Université de Lille/Ircav-Sorbonne Nouvelle. Elle analyse les usages expressifs et citoyens des technologies numériques depuis de nombreuses années. Elle a publié Mythologie du portable (Cavalier Bleu, 2010). Elle est aussi la co-traductrice avec Delphine Gardey et Nathalie Magnan de Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, Fictions, Féminismes (Exils, 2007). Elle s’intéresse actuellement à une « écologie de la communication dans le sillage notamment de l’association qu’elle a co-fondé Labo Citoyen/Citoyens Capteurs ou encore de ses dernières co-publications, dont Sciences du design n°11. Anthropocène et Effondrement (PUF, 2019) avec Alexandre Monnin. Elle est enfin experte à l’ANSES dans différents groupes de travail.
Maël Montévil
CNRS/ ENS
Maël Montévil est chargé de recherche au CNRS, à la République des savoirs, UAR 3608, École Normale Supérieure. Il est biologiste théoricien travaillant au carrefour de la biologie expérimentale, des mathématiques et de la philosophie. Il a développé le cadre de la clôture entre contraintes et travaillé sur l’historicité biologique et ses implications pour la théorie et la modélisation. Ses travaux portent aussi sur des problématiques actuelles telles que les perturbateurs endocriniens et, plus généralement, les disruptions du vivant dans l’Anthropocène et nos réponses à celles-ci, notament dans le cadre de ses travaux inités avec Bernard Stiegler. Maël Montévil est l’auteur de plus de trentes articles dans des revues internationales et d’une monographie avec Giuseppe Longo : Perspectives on Organisms.
Michäel Crevoisier
Université De Franche-Comté
Michaël Crevoisier est Maître de conférences en philosophie et membre du laboratoire des Logiques de l’agir à l’Université Marie et Louis Pasteur (Besançon), ses travaux portent sur la philosophie française contemporaine, notamment Simondon (Être un sujet connaissant selon Simondon, Classiques Garnier, 2023), Deleuze (dossier “Deleuze : lectures de Différence et répétition“, Philosophique, 2025) et Sartre, ainsi que sur les effets de l’évolution technique sur les pratiques esthétique (dossier “Sentir la matière numérique : un apport esthétique des jeux vidéo”, Études Digitales, n°16, 2025).
Pierre Saint-Germier
IRCAM
Pierre Saint-Germier est chargé de recherches au CNRS en philosophie, affecté à l’unité Sciences et Technologies de la Musique et du Son de l’IRCAM. Ayantune double spécialisation d’un côté en logique et épistémologie, et de l’autre en philosophie de la musique, il a mené des recherches sur les expériences de pensée, la logique de l’imagination, et l’improvisation musicale. Il a coordonné l’ouvrage Language, Evolution, and Mind (College Publications, 2018) et co-édité et co-traduit avec Clément Canonne deux volumes d’écrits sur la musique du philosophe états-unien Jerrold Levinson (Essais de Philosophie de la Musique, Vrin, 2015; L’expérience musicale, Vrin, 2020). Son programme de recherche actuel porte sur la philosophie du son et de la musique à l’ère de sa reproductibilité numérique. Il s’agit d’utiliser la musique et le son comme un prisme à l’aune duquel étudier les conséquences de la révolution numérique et de l’intelligence artificielle sur notre condition contemporaine. Parallèlement à ses recherches, il s’entoure volontiers de claviers de piano et de synthétiseurs. Il a participé au programme d’été de la School for Improvisational Music à New York (2017).
Mathieu Triclot
UTMB
Mathieu Triclot est maître de conférences en philosophie à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, membre de l’Institut FEMTO-ST/RECITS. Ses recherches, en philosophie des techniques, portent sur la cybernétique, la notion d’information, les paradigmes de la computer science et les jeux vidéo. Il est l’auteur du Moment Cybernétique et de Philosophie des jeux vidéo.
Marie-Claude Bossière
IRI
Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre praticien hospitalier, milite pour une information concernant les effets des écrans sur le développement des jeunes enfants avec le collectif CoSE (Collectif Surexposition Ecrans). Elle participe à la recherche de clinique contributive initiée par Bernard Stiegler, à St Denis. Sa dernière publication, « Le bébé au temps du numérique », aux éditions Hermann, explore la notion de disruption relationnelle, en lien avec les théories du développement psychologique, moteur et affectif de l’enfant, et la dimension essentielle d’interaction évolutive de l’enfant avec son milieu.
Nathalie Greenan
CNAM
Nathalie Greenan est économiste, spécialiste de l’analyse des changements au sein des organisations privées et publiques, de leurs performances économiques et de leurs conséquences pour les salariés et sur le marché du travail. Professeure des Universités au CNAM et membre du LIRSA, elle dirige scientifiquement les programmes de recherche transversaux Changements organisationnels, travail et emploi du CEET et Politiques des organisations de la Fédération de Recherche CNRS TEPP.
Nayla Glaise
UGICT-CGT et Eurocadres
Nayla Glaise est la présidente d’Eurocadres, organisation syndicale européenne représentant plus de 5 millions de cadres. Elle est également membre de l’Union générale des ingés, cadres et techs (Ugict-CGT), et négociatrice de l’Accord national interprofessionnel de 2020 et de l’accord UE
Amaranta Lopez
EHESS
Amaranta Lopez est chercheuse en philosophie à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ses recherches portent sur les approches féministes intersectionnelles de l’intelligence artificielle, et sur le cadre analytique émergent du colonialisme des données. Elle s’intéresse également aux discours autour de la diversité et l’inclusion dans l’industrie technologique française. Elle est affiliée à l’Observatoire International sur les Impacts Sociétaux de l’Intelligence Artificielle et du Numérique.
Elle s’intéresse de manière générale aux approches théoriques et formes d’organisation politique orientées justice sociale. Elle cherche à comprendre les impacts de la datafication et des technologies algorithmiques sur les inégalités et les rapports de domination de genre et de race, ainsi qu’aux formes de résistance qui s’articulent autour des technologies digitales. Elle porte un intérêt particulier au « visage épistémique » de l’oppression et de la résistance : aux injustices épistémiques, épistémologies de l’ignorance, épistémologies non-hégémoniques (féministes, décoloniales), et épistémologies des Suds.
Ariel Kyrou
écrivain et journaliste
Ariel Kyrou est écrivain, journaliste, et chercheur des imaginaires de bifurcation des citoyens ici et maintenant. Comme essayiste hétérodoxe et rêveur de projets de transformation terrestres et libertaires, Ariel Kyrou utilise la science-fiction pour penser (et panser) notre aujourd’hui.
Anaïs Nony
philosophe
Philosophe, responsable de recherche à l’Institut d’Études Avancées de Johannesburg et chercheuse associée à l’Institut de Recherche et d’Innovation de Paris, Anaïs Nony est titulaire d’un doctorat de l’Université du Minnesota et est autrice de Performative Images (Amsterdam University Press, 2023), co-éditrice de l’ouvrage The Edinburgh Companion to Gilbert Simondon (Edinburgh University Press, 2025) et de la revue de philosophie La Deleuziana : une rivista che desidira.
Valérie Cordy
La Fabrique de Théâtre
Valérie Cordy est artiste et metteuse en scène. Depuis 2013, elle est directrice de la Fabrique de Théâtre, le Service des arts de la scène de la Province de Hainaut en Belgique et y développe une forte politique de résidences d’artistes (40 compagnies accueillies par an). Membre du comité de programmation du festival de musiques et philosophie les Rencontres Inattendues (Tournai), elle développe aussi de nombreuses performances numériques et artistiques, dont dernièrement « État du monde », une série de spectacles qui racontent le monde tel qu’il advient.
François Pachet
chercheur en IA
François Pachet est membre associé au LIP6 (Sorbonne Université) et chercheur en intelligence artificielle et musique. Ancien directeur de Sony CSL Paris et responsable de la recherche en technologies créatives chez Spotify, il est l’un des pionniers de la création musicale assistée par IA. Ses travaux portent sur les modèles génératifs, l’interaction homme–machine et les fondements théoriques de la créativité computationnelle.
Farah Khelil
artiste
Artiste et auteure, diplômée des Beaux-arts de Tunis et titulaire d’un doctorat en Arts et Sciences de l’art à l’École des Arts de la Sorbonne, Farah Khelil interroge son rapport à la culture visuelle et ses effets sur l’individuel et le collectif. Elle expose dans des lieux institutionnels, galeries et foires internationales. Elle enseigne les arts plastiques en école d’art et à l’université. Elle est chercheuse associée à l’Institut ACTE (EA 7539) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Veuillez trouver son site web en cliquant ce lien.
Caroline Zeller
artiste
Caroline Zeller est une artiste visuelle et directrice artistique basée à Lyon. Elle a collaboré avec Google, La Samaritaine, le Studio Reisinger et JB Dunckel (cofondateur du groupe Air). Caroline a créé l’œuvre officielle du 25e anniversaire de Google France et la première pochette au monde conçue à l’aide d’IA génératives. Elle a animé de nombreux ateliers et conférences, formant plus de 500 créatifs aux usages de l’IA générative dans la création visuelle.
Après deux années d’expérimentation, elle a choisi de s’éloigner de ces technologies, dont elle dénonce l’opacité, le coût écologique et social. Son travail s’inscrit dans une démarche critique et explore des formes de création affranchies des logiques extractives des grandes plateformes.
Nathalie Casemajor
Centre Urbanisation Culture Société, INRS
Nathalie Casemajor est professeure-chercheure au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS (Institut national de la recherche scientifique, Montréal). Elle s’intéresse aux croisements entre culture, technologie et territoires. Ses travaux récents portent sur les plateformes de savoir globalisé, les communs numériques, les cultures de données, les scènes technologiques et la blockchain.
À l’INRS, elle est titulaire de la Chaire de recherche sur les communs numériques (2025-2030).
Elle dirige aussi la Chaire Fernand-Dumont sur la culture depuis 2025.
Camille Françoise
Wikimedia France
Camille Françoise est spécialisée dans les politiques culturelles, œuvrant à l’intersection des technologies numériques et du droit à l’information. Son parcours mêle des fonctions au sein de la Fédération internationale des associations de bibliothèques (IFLA), de Creative Commons et des institutions culturelles patrimoniales en France et à l’étranger, avec pour objectif : défendre les biens communs numériques, promouvoir les technologies ouvertes, préserver le domaine public et les droits humains dans les espaces publics numériques.
Aujourd’hui, elle poursuit son engagement au travers de plusieurs organisations, dont le conseil d’administration de Wikimédia France. Elle est également membre de COMMUNIA pour la protection du Domaine Public, du Réseau des Professionnels d’Europeana, de Deuxfleurs, Software Heritage et en tant qu’observatrice au sein d’EDRI (European Digital Rights)
Francesca Musiani
CIS-CNRS
Francesca Musiani est docteure en socio-économie de l’innovation de MINES ParisTech (2012), est chargée de recherche au CNRS depuis 2014, et directrice adjointe du Centre Internet et Société du CNRS (UPR 2000) qu’elle a cofondé avec Mélanie Dulong de Rosnay en 2019. Elle est également chercheuse associée au Centre de sociologie de l’innovation (i3/MINES ParisTech) et Global Fellow auprès de l’Internet Governance Lab de l’American University à Washington, DC.
Depuis 2006, les travaux de Francesca portent sur la gouvernance de l’Internet, dans une perspective interdisciplinaire qui puise dans les sciences de l’information et de la communication, les science and technology studies (STS) et le droit international. Ses recherches récentes portent sur le développement et les usages des technologies de chiffrement dans les outils de messagerie (projet européen H2020 NEXTLEAP, 2016-2018), les « résistances numériques » à la surveillance et à la censure dans l’Internet russe (projet ANR ResisTIC, 2018-2021), et la gouvernance des archives du Web (projet ANR Web90, 2014-2017 et projet CNRS Attentats-Recherche ASAP, 2016). Ses travaux théoriques explorent les approches STS à la gouvernance d’Internet, avec une attention particulière aux controverses socio-techniques et à la gouvernance « par l’architecture » et « par l’infrastructure ».
Alexandre Monnin
philosophe
Alexandre Monnin est philosophe, enseignant et auteur. Il est directeur scientifique d’Origens Media Lab, cofondateur de l’initiative Closing Worlds. Il dirige le Master of Science “Strategy & Design for the Anthropocene”, porté conjointement avec Strate École de Design à Lyon. Avant cela, il a été chercheur chez Inria Sophia Antipolis (2014-2017), fellow à l’IKKM (Université du Bauhaus, 2013) et responsable recherche Web à l’Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou (2010-2013). Docteur en philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sa thèse a porté sur la philosophie et l’architecture du Web (2013). Il est l’un des co-auteurs du rapport intitulé “Pour une sobriété numérique” publié par le Shift Project en 2018. Avec Diego Landivar et Emmanuel Bonnet, il a publié “Héritage et Fermeture” (Éditions Divergences, 2021), et “Politiser le Renoncement” (Éditions Divergences, 2023), et édité “Écologies du Smartphone” avec Laurence Allard et Nicolas Nova (Bord de l’eau, 2022).
Francis Jutand
Institut Mines-Télécom
Formé à l’ENS Cachan, Francis Jutand débute sa carrière à Télécom ParisTech en 1975 puis à Télécom Bretagne de 1992 à 1996. Il devient ensuite directeur scientifique de France Télécom R&D et contribue à la création de réseaux de recherche sur les technologies clés. En 2000, il devient le directeur du département STIC du CNRS et travaille à partir de 2004 au développement de pôles de compétitivité, notamment de Cap Digital dont il est toujours vice-président Recherche & prospective. Il devient en 2006 directeur scientifique de l’Institut Télécom, groupe des écoles Télécom, partenaire de plusieurs pôles STIC mondiaux, labellisé Carnot pour la qualité de sa recherche partenariale, acteur majeur des PCRDT européen et membre de l’alliance nationale Allistène, créée en 2009. Francis Jutand est également un des créateurs de la Fondation Télécom et du think tank Futur numérique. Depuis mars 2012, il était le directeur scientifique de l’Institut Mines-Télécom. Il est également membre du Conseil National du Numérique et l’auteur de l’ouvrage collectif La métamorphose numérique.
Franck Cormerais
IRI, Université Bordeaux Montaigne
Franck Cormerais est professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Bordeaux-Montaigne. Il est également responsable de l’axe Études digitales : des donnés aux dispositifs (E3D) au sein du laboratoire MICA et co-directeur de la Revue Études Digitales publiée chez Classiques Garnier. Ses recherches portent sur l’anthropologie des technologies contemporaines et sur l’usage des TIC en milieu urbain. Son programme comporte deux axes. Le premier est lié à l’établissement de nouvelles pratiques éditoriales en ligne. Le second s’intéresse à l’industrialisation contemporaine du langage et de la culture, et plus aux généralement aux processus d’innovation et de valorisation dans le cadre d’une économie de la contribution.
Bertrand Delezoide
BleuAI
Bertrand Delezoide est un expert français en intelligence artificielle, spécialisé en IA générative, traitement du langage, vision et données multimodales.
Cofondateur et président de BleuAI, il développe des modèles fondamentaux d’IA pour des secteurs régulés comme la santé, la finance et la défense.
Ancien élève de l’ENS Cachan, docteur (UPMC) et habilité à diriger des recherches, il a dirigé pendant près de dix ans le laboratoire LASTI au CEA LIST.
Il y a piloté plus de 50 projets de R&D pour 18 M€ de financements publics et industriels.
Professeur associé à l’Université Paris-Saclay, il enseigne l’IA générative et les modèles probabilistes.
Ses travaux portent sur l’IA générative multimodale, la prédiction complexe et l’IA explicableFlorence Jamet-Pinkiewicz
École Estienne
Florence Jamet-Pinkiewicz est responsable du DSAA Design & Création en environnement Numérique (DSAA DCN, Diplôme Supérieure des Arts appliqués, niveau master), et professeure à l’Ecole Estienne, Paris.
Agrégée d’Arts Appliqués et ancienne élève du département Design de l’École Normale Supérieure Paris-Saclay. Jury de diplôme en Mastère spécialisé Création et Technologie Contemporaine, à l’ENSCI. Auteure de « L’Infini du livre, entre numérique et tangible », in Sciences du design, n°9, 2018 Et « Animismes numériques. La magie au secours de la foi en la technique » in Religions et technique : cultures techniques, croyances, circulations de l’Antiquité à nos jours, éd. par Guillaume Carnino, Liliane Hilaire-Perez et Sébastien Pautet, TurnhoutMathieu Corteel
Sciences Po
Mathieu Corteel, philosophe et historien des sciences, est chercheur postdoctoral au CrisisLab de Sciences Po, à l’Institut des maladies génétiques Imagine et chercheur associé au département d’histoire des sciences de Harvard. En tant que lauréat de la bourse Arthur Sachs, il a mené des recherches et enseigné à Harvard entre 2022 et 2025. Ses recherches portent sur la philosophie et l’histoire des probabilités et des technologies appliquées à la santé. Il mène actuellement des recherches de terrain à l’Institut Imagine sur la médecine génétique. Il est l’auteur de deux ouvrages Le Hasard et le Pathologique, Presses de Sciences Po, 2020 et Ni dieu ni IA, une philosophie sceptique de l’intelligence artificielle, Les éditions La découverte, 2025.
Ressources
Vous pouvez retrouver les enregistrements des ENMI préparatoires 2025 en suivant ce lien.
Allard, Laurence, « Techno-critique, écocritique, faire-critique, du smartphone. Pour un numérique décolonial ». Écologies du smartphone (2022).
Alombert Anne, « Assurer nos libertés à l’ère de l’intelligence artificielle ». https://cnnumerique.fr/nos-travaux/assurer-nos-libertes-lere-de-lintelligence-artificielle
Bossière, M.-C. (2021). VII. Pulsion de vie-pulsion de mort disruption entropie-anti entropie. Le bébé au temps du numérique : L’humanité au risque des disrupteurs relationnels (p. 151-164). Hermann. https://shs.cairn.info/le-bebe-au-temps-du-numerique–9791037008725-page-151?lang=fr.
Boullier, Dominique (2025). Médias sociaux, machines à chaos. Inflexions, 59(1), 117-125. https://doi.org/10.3917/infle.059.0117.
Bachimont, Bruno, « L’espace-temps du calcul: position virtuelle et distance réelle », Signata. Annales des sémiotiques/Annals of Semiotics 16 (2025).
Casemajor, Nathalie, « Data cultures: Contested meanings in a public cultural institution », Big Data & Society 12, no. 3 (2025): 20539517251381671.
Chaix Victor, Lehuger Auguste, et Sapey-Triomphe Zako, « Pourquoi l’intelligence artificielle voit Barack Obama blanc ? », Le Monde Diplomatique, https://www.monde-diplomatique.fr/2024/11/CHAIX/67723
Crevoisier, Michaël, « L’imagination artificielle est-elle créatrice ? », Philosophique, 27 https://doi.org/10.4000/philosophique.1827
Cordy, Valérie. « Pour un enseignement du numérique en école d’art: généalogie, fiction et expérience du code », L’Observatoire 58, no. 2 (2021): 53-56.
Cormerais, Franck. Hyperville (s): construire des territoires solidaires. Éditions de l’Aube, 2021.
Corteel, Mathieu. Ni dieu ni IA: Une philosophie sceptique de l’intelligence artificielle. La Découverte, 2025.
Glaise, Nayla, 2024. Luttes et conditions de travail en Europe. La Pensée, 417(1), pp.50-59.
Greenan, N. and Napolitano, S., 2024. Digital technologies, learning capacity of the organization and innovation: EU-wide empirical evidence from a combined dataset. Industrial and Corporate Change, 33(3), pp.634-669.
Jamet-Pinkiewicz, Florence. « Ré-interfacer les IA: du prompt au design d’interface », Entretiens du Nouveau Monde Industriel Préparatoires 2025. 2025.
Jutand, Francis, and Daniel Kofman. « Le rôle de l’IA dans l’évolution des infrastructures numériques du futur. » Annales des Mines-Enjeux numériques 27.3 (2024): 193-199.
KHATCHATOUROV, Armen. (2024) L’Intelligence Artificielle et ses « contextes » : entre l’éthique et le politique. Interfaces numériques, 12. DOI: 10.25965/interfaces-numeriques.5117
Krzykawski Michał, « Panser la cognition », Appareil, https://journals.openedition.org/appareil/6624
Longo Giuseppe, « Le cauchemar de Prométhée », https://www.di.ens.fr/users/longo/files/Couv_Table-introLeCauchemarPromethee.pdf
Manuel Zacklad et Antoinette Rouvroy, « L’éthique située de l’IA et ses controverses », Revue française des sciences de l’information et de la communication [En ligne], 25 | 2022, http://journals.openedition.org/rfsic/13204 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rfsic.13204
Monnin Alexandre, « Politiser le renoncement », OPCD, https://polen.uca.fr/revue-opcd/index.php?id=343
Musiani, Francesca, « Infrastructuring digital sovereignty: a research agenda for an infrastructure-based sociology of digital self-determination practices », Information, communication & society 25.6 (2022): 785-800.
Montévil, Maël, 2025. Disruption of biological processes in the anthropocene: The case of phenological mismatch. Acta Biotheoretica, 73(2), p.5
Nony, Anaïs. “Proletarianization of the Mind: A Media Theory of Artificial Intelligence after Simondon and Stiegler.” (2024).
Obin, N., Saint-Germier, P., Giavitto, J.L., Madlener, F., Roebel, A. and Bevilacqua, F., 2024. Pour une intelligence artificielle responsable au service d’une création musicale, inventive et diverse. Culture et recherche, 147, pp.ISSN-papier.
Simoncini Nicolas, Triclot Mathieu, et Noûs Camille, « Pour une démarche de conception orientée milieux », Techniques & Culture, https://journals.openedition.org/tc/18585
Szendy, Peter, 2021. Viral Times. Critical Inquiry, 47(S2), pp.S63-S67
Triclot, Mathieu, « Ontology and politics of information in the first cybernetics », in Yuk Hui (ed.),
Cybernetics for the 21th century : vol. 1 epistemological reconstruction, Hanart Press, 2024, p. 67-
84 (ISBN : 97-988-70268-0-8).
X-alternative, « Intelligence artificielle : pour l’émergence d’alternatives, refonder une politique scientifique, industrielle et sociale de l’IA », https://x-alternative.org/2024/10/30/intelligence-artificielle-refonder-une-politique-scientifique-industrielle-et-sociale-pour-lemergence-dalternatives/
L’espace ressources recueille les recommandations des intervenants et du public des ENMI. Il est conçu en partenariat avec la revue Etudes digitales.
Inscription
Veuillez vous inscrire en remplissant et soumettant le formulaire ci-dessous.
Vous pouvez aussi le retrouver à l’url suivante : https://framaforms.org/les-entretiens-du-nouveau-monde-industriel-2025-1743716762
Éditions précédentes
2024 : La nouvelle écologie de l’industrie
Voir le site de l’édition 2024
Voir les vidéos de l’édition 2024
2023 : Jeux, gestes et savoirs
Voir le site de l’édition 2023
Voir les vidéos de l’édition 2023
2022 : Organisation du Vivant, Organologie des Savoirs
Voir le site de l’édition 2022
Voir les vidéos de l’édition 2022
2021 : LA SOCIÉTÉ INTERMITTENTE : LA VIE DANS LE (NÉGU)ANTHROPOCÈNE
Voir le site de l’édition 2021
Voir les vidéos de l’édition 2021
2020 : PRENDRE SOIN DE L’INFORMATIQUE ET DES GÉNÉRATIONS
Voir le site de l’édition 2020
Voir les vidéos de l’édition 2020
2019 : INTERNATIONAL, INTERNATION, NATIONS, TRANSITIONS : PENSER LES LOCALITÉS DANS LA MONDIALISATION
Voir le site de l’édition 2019
Voir les vidéos de l’édition 2019
2018 : L’INTELLIGENCE DES VILLES ET LA NOUVELLE RÉVOLUTION URBAINE.
Voir le site de l’édition 2018
Voir les vidéos de l’édition 2018
2017 : BÊTISE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLES.
Voir le site de l’édition 2017
Voir les vidéos de l’édition 2017
2016 : PENSER L’EXOSOMATISATION POUR DEFENDRE LA SOCIETE.
Voir le site de l’édition 2016
Voir les vidéos de l’édition 2016
2015 : LA TOILE QUE NOUS VOULONS : du web sémantique au web herméneutique.
Voir le site de l’édition 2015
Voir les vidéos de l’édition 2015
2014 : LA “VÉRITÉ” DU NUMÉRIQUE
Voir le site de l’édition 2014
Voir les vidéos de l’édition 2014
2013 : LE NOUVEL ÂGE DE L’AUTOMATISATION
Voir le site de l’édition 2013
Voir les vidéos de l’édition 2013
2012 : Digital Studies, organologie des savoirs et technologies industrielles de la connaissance.
Voir le site de l’édition 2012
Voir les vidéos de l’édition 2012