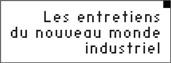Session 5 – Pour une économie de la contribution : cadre juridique et cadre de confiance
17 décembre
14H30-17H
Un plaidoyer pour la reconnaissance et le soutien des dynamiques collaboratives et contributives et des règles juridiques qui dans le numérique et à l’image de Wikipédia, cherchent à défendre un milieu des savoirs ouvert sans qu’il soit l’objet d’une nouvelle forme de prédation pour nourrir (et sauver) une IA qui sinon s’appauvrit tendanciellement. Quels modèles économiques pour une redistribution plus équitable de ces profits ? Quel soutien financier à la contribution dans le contexte de territoires où les habitants, artistes, amateurs, s’appuient sur leurs « donnée contribuée » sans les commercialiser ? Comment aller au-delà de l’open source pour penser un « share source » fondé sur des données contribuées comme nous y invite aussi Francis Jutand ?
Intervenants
Nathalie Casemajor, Centre Urbanisation Culture Société, INRS — Le projet Wikimedia Entreprise
- En 2021, Wikimédia a lancé une filiale commerciale nommée Enterprise. Vingt ans après la création de Wikipédia, pourquoi ce mouvement emblématique du Web collaboratif et de l’Internet non marchand, a-t-il pris cette direction ? Je propose d’analyser cette initiative comme le plus récent chapitre d’une longue histoire d’entre-prises (au sens d’attaches mutuelles) entre un commun du numérique et les géants de la Tech. À travers sa filiale Entreprise, la WMF vise à bâtir une interface avec le capitalisme de plateforme, au sein d’un système d’acteurs commerciaux interconnectés, sans pour autant renoncer à son modèle distinct de production et de gouvernance guidé par une éthique F/LOSS. En s’appuyant sur les différentes prises qui l’attachent à Google, Wikimédia cherche ainsi à exercer un certain pouvoir de définir les termes de leur relation structurante.
Camille Françoise, Wikimedia France — Wikipedia vs Grokipédia: Vers quelle économie de l’internet ouvert voulons-nous aller ?
- En mars 2026, nous célébrerons les 25 ans de Wikipédia en Français. Cela signifie 25 ans depuis l’émergence d’une infrastructure numérique unique, qui soutient la participation, la contribution, la collaboration de l’ensemble des individus. Pour Wikimédia France, l’objectif est simple : favoriser le partage de l’information pour tous et toutes, gratuitement, grâce à la contribution et à l’effort collectif d’êtres humains. Notre communauté de bénévoles s’active chaque jour, de manière presque invisible, à apporter des sources fiables dans les articles ou apporter d’autres perspectives pour nuancer des propos. Dans un écosystème numérique de surveillance, développé autour de l’économie de l’attention et de la collecte des données, les projets Wikimédia proposent un modèle singulier : pas de publicité, pas de collecte de données, pas d’algorithme de recommandation. Et pourtant, entre l’arrivée des entreprises d’Intelligence Artificielle qui absorbent nos contenus : articles, pages de discussions, visuels, et les régulations européennes, nous faisons face à des difficultés pour maintenir l’unicité de notre modèle, tout en demandant une équité économique et législative que ce soit en France ou dans l’Union.
Francesca Musiani, CIS-CNRS — Souveraineté numérique (européenne) et architectures de réseau fédérées
- Cette intervention, qui s’appuie sur une enquête en cours avec Ksenia Ermoshina, discutera comment les différentes propriétés techniques des services numériques qui sous-tendent une architecture de réseau fédérée (telles que l’interopérabilité, l’auto-hébergement, la portabilité, la modularité) sont actuellement invoquées et mobilisées par certains régulateurs de l’Internet afin de servir des objectifs d’autonomie numérique et infrastructurelle. La question plus générale posée par la contribution concerne la controverse autour de l’appropriation ou de la cooptation, par différents acteurs institutionnels et de régulation, d’outils et protocoles alternatifs développés par les communautés du logiciel libre. L’intervention décrit la rencontre entre un monde de créateurs (techniques) de solutions décentralisées et des demandes, nouvelles ou reformulées, d’acteurs publics animés par des enjeux de souveraineté numérique, qui conduisent à négocier et faire évoluer (ou non) ces architectures. En décrivant cette rencontre, ce sont bien la circulation et la transformation des éléments d’infrastructure entre ces mondes qui se voient explicitées.
Alexandre Monnin, philosophe — UsageRight : vers des IA génératives situées et réciproques
- Les IA génératives reposent sur une extraction massive de contributions et sur des actes d’usage (entraîner, affiner, générer). La licence UsageRight, initialement développée pour le monde de la recherche, propose des micro-contrats d’usage explicites et traçables, conditionnant ces actes à des obligations de réciprocité dont l’exploration (attribution, partage d’améliorations, redevances, restitution d’évaluations) constitue aujourd’hui un enjeu majeur. En s’appuyant sur les piliers de l’IA décentralisée (confidentialité, vérifiabilité, incitations, orchestration, expérience utilisateur), UsageRight introduit une friction éthique : rendre visibles et négociables les conditions d’usage. Il rend ainsi possibles des IA locales et des communs data où chacun peut prouver sa contribution, tarifer à l’usage et retirer son consentement via des protocoles d’unlearning (désapprentissage sélectif).
Francis Jutand, Institut Mines-Télécom — Coopération et apprentissage autour des données : Une transformation cognitive en profondeur de la société, de l’économie et de l’éducation
- Avec le numérique l’économie de la connaissance a pris son essor. Avec comme matière première les données, comme moteur de production le traitement de l’information et l’intelligence artificielle, comme accélérateur la coopération, elle produit des connaissances, des contenus, des algorithmes, des outils, utilisables dans la création de services et de produits. Mais cette révolution va bien au-delà, en s’appuyant sur la coopération et la coopétition dans les apprentissages pour le développement des capacités cognitives, elle va être source d’innovation, de création de richesses et d’interactions sociales nouvelles, et transformer en profondeur, le fonctionnement des entreprises, des administrations, de l’éducation et des activités collectives.