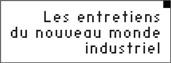Session 3 – Synthèse artificielle, nouveaux métiers, nouveaux collectifs
16 décembre
16H30-19H
Une étude critique des publications contradictoires sur la destruction de l’emploi par les IA ne suffit pas. Il convient de reconnaître l’importance du « digital labor10 » et la misère physique, psychique et symbolique des travailleurs du clic11. Mais aussi distinguer ce qui au cœur de nos métiers relève à présent de tâches automatisables–en analyse comme en synthèse des connaissances–sans les confondre avec leur pratique collective dans le champ incalculable des savoirs. S’agit-il d’une destruction nette de l’emploi ou plutôt d’une déqualification tendancielle due à la prolétarisation qui s’inscrit désormais de manière générale et selon une échelle planétaire? A qui bénéficie cette nouvelle productivité et comment peut-elle être mobilisée pour dégager de nouveaux espaces d’autonomie, de savoir, de pratiques contributives et donc d’un travail qui se distingue de l’emploi ?
Intervenants
Manuel Zacklad, DICEN-CNAM — Algorithmes et services : repenser les médiations et la production de valeur
- Partant du constat d’un manque persistant de prestations servicielles de qualité dans la plupart des grands secteurs, soin, éducation, alimentation, transport, finance et assurances, immobilier, protection sociale, sécurité, etc., cette intervention questionne la croyance selon laquelle davantage d’automatisation garantirait une amélioration de la qualité quand toutes les études empiriques disponibles montrent précisément l’inverse. L’incapacité des décideurs publics et des médias à intégrer les résultats des travaux en sciences humaines et sociales sur la coproduction de la valeur, tant dans le travail que dans la consommation, laisse le champ libre aux discours d’escorte portés par les industriels. Ces derniers tirent des profits considérables de cette vision réductrice et s’accommodent aisément de l’appauvrissement progressif des classes moyennes. C’est bien la perspective d’une approche augmentative et non pas substitutive des technologies qui fait encore défaut pour analyser les effets des technologies utilisant les algorithmes de l’IA et la manière d’en tirer profit dans le sens du développement humain.
Nathalie Greenan, CNAM-CEET et LIRSA — IA et emploi : pourquoi les transformations passent par le travail ?
- Cette communication s’appuie sur une analyse critique des travaux prédictifs d’exposition au risque d’automatisation par l’IA pour mettre en évidence leurs limites méthodologiques et leur caractère techno-déterministe. Face à une vision qui considère l’automatisation et l’augmentation comme des propriétés intrinsèques des technologies, cette intervention défend une perspective alternative : les conséquences sur l’emploi passent nécessairement par les transformations concrètes du travail. Les bénéfices documentés de l’usage des IA côtoient des écueils encore largement sous-estimés. Pour tirer parti des nouvelles opportunités ouvertes par le déploiement de ces technologies en milieu de travail et aller vers des usages réellement novateurs, susceptibles de répondre aux besoins individuels et collectifs dans le respect des limites planétaires, il convient d’investir dans la capacité d’apprentissage des organisations. Cela implique de prendre appui sur l’expérimentation, le dialogue professionnel et le dialogue social pour déterminer collectivement et réguler les usages des IA.
Nayla Glaise, dirigeante de l’UGICT-CGT et d’Eurocadres — L’impact de l’IA sur la santé et la sécurité des travailleur.se.s
- Le lien entre les systèmes d’IA et les risques psychosociaux reste clair. Si ces technologies pourraient constituer une ressource pour prévenir et atténuer les risques psychosociaux au travail, les études montrent qu’au contraire, les systèmes amplifient un certain nombre de risques. Comment intégrer ces systèmes dans la vie professionnelle tout en prévenant les risques ?
Amaranta Lopez, EHESS — Imaginaires domestiques de l’IA
- Alliant féminisme de la reproduction sociale et féminisme post-humain, cette communication vise à examiner le caractère disruptif de l’IA dans l’espace domestique compris comme un terrain de dispute entre capitalisme et luttes sociales, en particulier féministes. Par la (dés)incarnation de l’archétype domestique de la femme au foyer, les assistantes vocales permettent de prolonger et reconfigurer une subjectivité à la fois consumériste et dominante, tout en invisibilisant le travail humain (genré et racialisé) derrière les chaînes de production et d’approvisionnement, agissant ainsi comme dispositif de micropédagogies du quotidien au service du colonialisme des données/capital algorithmique.