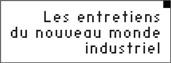Session 1 – Synthèse artificielle et contribution : critique et prospective techno-politique et industrielle
16 décembre
9H30-12H30
Une vision historique et prospective sur la composante synthétique de l’IAG qui disrupte l’économie mondiale dans le contexte d’un techno-capitalisme hors sol qui tend, par les IA générales ou génériques à réduire ses contextes, métiers, territoires à leur calculabilité, et court le risque d’une dégradation de ses performances s’il ne tisse pas de nouvelles alliances avec la contribution humaine et en premier lieu avec la science. Quel régime de vérité ou quel régime de « facticité », pour reprendre le terme d’Antoinette Rouvroy, se dessine avec cette disruption ?
Introduction
Vincent Puig, IRI
Manuel Zacklad, CNAM
Intervenants
Guillaume Pellerin, IRI — Architectures, méthodes et limites synthétiques
- Les systèmes de synthèse artificiels modernes – abusivement désignés comme intelligents – proposent un ré-agencement inédit des langages, des savoirs et des disciplines scientifiques. La présentation propose une revue générale des concepts, méthodes et procédés technologiques qui permettent la conception d’automates conversationnels imitant les langages, les images et les sons naturels. Les approches statistiques, symboliques et les techniques de synthèse y sont comparées pour faire émerger des problématiques industrielles, juridiques, éthiques et noétiques. Une analogie physico-computationnelle montre que les “IA” sont en fait des systèmes de modélisation physique relativement classiques mais dont l’architecture verrouille a priori toute capacité épistémologique d’envergure. Face à la diffusion fulgurante des applications nourries de capacités de calculs hyper-centralisés, hyper-capitalisés et aux résultats biaisés par les instabilités des modèles et les boucles de récursion, des voies de traitement sont proposées comme : la réhabilitation du champ sémantique et relationnel, la traçabilité inductive des sources décentralisées, la constitution d’interfaces paramétrées par les métiers et enfin la constitution d’une “Clinique des IA” qui permette le traitement collectif de ce nouveau Pharmakon.
Dominique Boullier, Sciences Po — IA génératives et LLM probabilistes : contre la tyrannie du retard, pour une sécession sémantique européenne
- La course à l’augmentation des paramètres, à l’accumulation de GPU et à la prédation massive de données pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle (IA) générative n’a rien d’une fatalité. DeepSeek prouve qu’il est possible de faire aussi bien avec moins. Mais surtout, de nombreux modèles plus petits commettent moins d’erreurs en réduisant la part de probabilités au profit d’une approche sémantique, renseignée par des experts d’un domaine professionnel restreint. Un choix civilisationnel est en cours : celui entre des IA probabilistes, opaques, irresponsables et coloniales, et des IA à fortes valeur sémantique ajoutée, explicables, responsables sur les plans légaux et écologiques, et contrôlables par les collectifs locaux concernés. Les solutions existent, qu’elles viennent du monde alternatif ou de solutions déjà commercialisées par des entreprises de toutes tailles
Giuseppe Longo, ENS — L’empire numérique de l’alphabet à l’IA
- On verra comment des machines, produisant des résultats à partir de moyennes statistiques ou par de l’apprentissage automatique construits en suivant des géodésiques (parcours optimaux) dans des espaces prédéfinis – enrichies d’un peu d’aléatoire physique, génèrent des banalités à partir de banalités moyennes, produisant du mal sans même qu’on le leur demande. Elles arrivent à le faire par l’itération et l’amplification de moyennes, par la recherche du maximum des corrélations, en excluant tout écart, en fait toute pensée en tant que toute pensée de ce qui est différent, de ce qui est nouveau. Qui plus est, ces « optima » et moyennes sont obtenus par la réduction de tout processus à des règles (des ”ordres”) de remplacement de suites de signes par des suites de signes où tout se calcule par la récursion sur des bases de données énormes, mais finies. Or, la récursion mathématique engendre une classe infinie et fort intéressante de fonctions, quand elle agît sur un ensemble infini (de nombres). Dans le Deep Learning, sous la forme d’une ”retro-propagation” décrite dans le continu, elle est à la base de techniques remarquables, dont on mettra en évidence quelques imites. Dans les LLM et leurs bases de données discrètes, elle produit l’ ”autophagie” et atteint la platitude de l’identique. On peut co-construire un nouveau milieu avec ces outils, comme les humains l’on toujours fait, si on développe une épistémologie critique, historique et scientifique du numérique. Cela doit s’accompagner d’une conscience technique des enjeux politiques implicites à une « organologie des savoirs », fondée sur des outils réflexifs et sur des méthodes de capacitation et de recherche contributive qui permettent à chacun de comprendre et dépasser les dangers d’une utilisation systématique et aveugle des processus d’optimisation statistique dans nos activités.
Antoinette Rouvroy, Un. de Namur — Le nouveau régime de facticité
Laurence Allard — Ne pas désespérer les écotones. Appropriations critiques de l’IA dans les industries créatives et culturelles.
- Ne pas désespérer les écotones… telle sera la promesse qui animera cette communication. Pendant que tous les esprits se tournent avec raison vers les puissances technologiques étatiques ou industrielles, nous voudrions mettre en lumière, suivant une perspective de sociologie des mobilisations en faveur des contre-anthropocène (Chateauraynaud, Debaz, 2017) des praticiens des cultures numériques qui œuvrent à des formes d’appropriation critique de l’IA et ouvrent ainsi des « écotones techno-culturels ». Les écotones constituent des zones de transition socio-écologique (Allard, Monnin, Tasset, 2019) et, dans le sillage des contre-sommets de l’IA et autres mobilisations actuelles, l’on peut y observer des expérimentations d’IA “situées” guidées par une logique de ré-attachement aux limites terrestres et de ré-articulation entre interactions entre milieux, cultures et technologies.